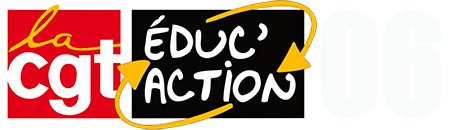Loin du conte
samedi 10 juin 2017
C’était hier. Je marchais dans la rue qui domine le port . Peu importe où je me rendais. J’étais là à frôler les terrasses de restaurants mangeurs d’espace public. Je regardais l’énorme ferry d’une compagnie italienne qui dégueulait ses chapelets de véhicules. J’appréciais l’ombre et la fraîcheur des arbres sur le trottoir. Je savourais la grenadine d’une glace à l’eau.
Et puis, je me suis arrêté parce qu’une voiture sortait d’une résidence privée. Peu importe son nom. C’est là que j’ai vu cet homme, assis contre le mur blanc de l’allée, dos appuyé sur ce mur et yeux rivés dans le vague d’un autre mur, lui aussi immaculé. « Défense de stationner » au-dessus de son crâne.
C’était un Africain. Sénégalais, Malien, Guinéen, Soudanais ? Plutôt accroupi qu’assis. Silencieux, impénétrable, aux vêtements lourds, des vêtements d’hiver. Accroupi, immobile dans un rectangle d’ombre et de fraîcheur entre le trottoir, la rue et une résidence qu’il ne connaîtra jamais. Avec des gens à jamais inconnus qui entraient et sortaient dans leurs autos, semblables à celles sorties du ventre du bateau. De l’immeuble sur l’eau.
Je ne pouvais pas m’arrêter longtemps parce que cela ne se fait pas de dévisager quelqu’un trop longuement. Ou alors, il faut aborder cette personne, entrer dans son champ de vision. Entrer en contact. Sourire, manifester de l’empathie. L’inconnu fait peur et les petites lâchetés prennent souvent le dessus. J’ai continué de marcher mais plus comme si de rien n’était. Le feuillage des arbres ne me rafraîchissait plus, la grenadine était amère.
Je savais, je sais que de nombreux migrants passent la frontière à cent kilomètres d’ici. Par les montagnes. Je sais qu’ils -hommes, femmes et enfants- ont déjà maintes fois risqué leur vie, maintes fois perdu leur argent, le peu de biens qu’ils possédaient. Je sais surtout que leur dignité est bafouée, niée et qu’il leur faut du courage pour ne pas sombrer dans la folie, le désarroi.
Je sais qu’ils passent des heures, des jours à attendre un rectangle de papier et que s’ils ne l’obtiennent pas, je sais qu’ils repassent des heures, des jours à gonfler les mêmes files d’attentes devant les mêmes façades. Je sais qu’ils passent des nuits fragiles cachés dans des jardins publics ou des parkings souterrains. Je sais que des gens les abritent. Sans réfléchir.
C’était hier, j’ai marché des kilomètres avant de rebrousser chemin, de retourner dans cette rue qui domine le port, de courir à perdre haleine jusqu’à l’allée de la résidence « La rose des sables » -ça y est, le nom me revient- mais en vain. L’homme accroupi n’était plus là, plus aucune trace de lui, pas même un papier, le soleil avait tourné et chassé l’ombre. Fait place nette à l’obscurité naissante. La gardienne qui sortait des conteneurs me demanda si je cherchais quelqu’un.
Coup de sirène. Le ferry transalpin repartait vers je ne sais quelles côtes après avoir avalé une nouvelle cargaison d’autos. Les limonadiers empilaient les chaises de leurs terrasses, deux chiens furieux se disputaient un cartilage et la gardienne tourna les talons.
Abasourdi. Je restai longtemps hagard, planté là comme un saule pleureur à suinter du remords.
Qu’avais-je fait de ma journée ?
Zirteq